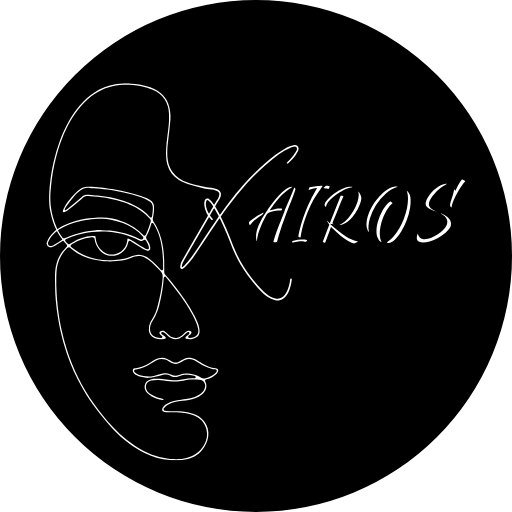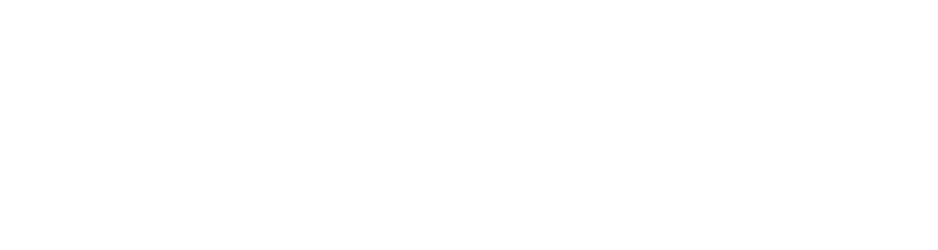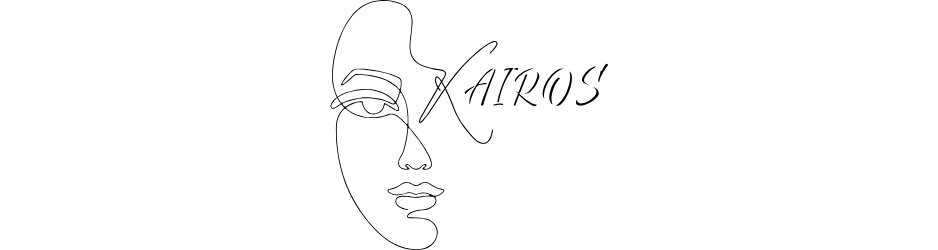Avez-vous été victime d’un grave accident de voiture qui vous hante au point de provoquer des insomnies ? Ressentez-vous une anxiété chronique depuis que vous avez subi une agression violente dans le métro ? Il se pourrait que vous soyez confronté(e) à un stress post-traumatique. Quels sont les symptômes ? Quelles solutions existent pour vous aider à surmonter cette épreuve ? Voici un éclairage sur le sujet.

Qu’est-ce que l’état de stress post-traumatique ?
Attentats, prises d’otages, catastrophes naturelles, abus sexuels, deuils : ces événements peuvent être particulièrement difficiles à gérer pour ceux qui les vivent ou les observent.
Alors que certains parviennent à tourner la page rapidement, d’autres peinent à se remettre de ces expériences traumatisantes, développant des symptômes physiques et psychologiques qui altèrent leur quotidien et les rendent très vulnérables.
C’est ce que l’on désigne comme « état de stress post-traumatique » ou « syndrome de stress post-traumatique ». Ce trouble anxieux sévère peut toucher des personnes de tous âges, y compris les jeunes enfants, entraînant une peur irrationnelle du danger, un sentiment d’insécurité et la conviction que la mort est imminente.
Les symptômes associés au stress post-traumatique varient d’une personne à l’autre, selon leur vécu et leur environnement familial, professionnel ou social. Ils peuvent se manifester quelques jours après le traumatisme ou apparaître plusieurs mois plus tard, souvent déclenchés par des odeurs, des images, des sensations ou des lieux liés à l’événement traumatisant.
Il est crucial d’intervenir rapidement en cas de stress post-traumatique pour limiter ses conséquences néfastes sur la santé physique et mentale et favoriser la guérison. À l’inverse, si la prise en charge est tardive, la victime risque de rester piégée dans un cycle de stress récurrent, aggravant son mal-être. Un diagnostic de stress post-traumatique est établi lorsque les symptômes persistent plus d’un mois, deviennent chroniques et invalidants.
Syndrome de stress post-traumatique : les symptômes
L’état de stress post-traumatique se caractérise par un ensemble précis de symptômes et de comportements, documentés dans le réputé « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » (DSM-5), qui compile les résultats d’études et les avis d’experts internationaux.
Ces symptômes se manifestent sous quatre formes principales :
1. **Reviviscence** : réapparition fréquente de l’événement traumatique à travers des flash-backs, des pensées ou des souvenirs intrusifs.
2. **Évitement** : tendance à fuir les situations, activités, lieux et personnes liés au traumatisme.
3. **Altérations cognitives et émotionnelles** : difficultés de mémoire et de concentration, ainsi que des modifications de l’état émotionnel.
4. **Hyperactivité du système nerveux** : symptômes tels que stress, irritabilité, colère, anxiété et ruminations.
Par ailleurs, des troubles concomitants peuvent accompagner ces symptômes, tels que douleurs diffuses, insomnies, sentiments de culpabilité (comme « j’ai survécu alors que d’autres sont morts »), phobies, attaques de panique, isolement, addictions et dépression. La chronicité de ces symptômes plonge la personne dans une détresse profonde dont il peut être difficile de se libérer.
Syndrome de stress post-traumatique : les symptômes
Certaines personnes ayant vécu un stress post-traumatique parviennent, avec le temps, à se libérer complètement des symptômes qui l’accompagnent. Cependant, la majorité nécessite un soutien continu pour aller mieux. Les victimes de tels traumatismes sont souvent traitées en priorité avec des antidépresseurs et/ou des anxiolytiques, visant à atténuer les effets immédiats du choc post-traumatique. Cependant, ces médicaments ne traitent que les symptômes superficiels, d’où la nécessité d’un accompagnement psychologique rapide pour éviter une dépendance médicamenteuse.
Pour évaluer la présence et la gravité du stress post-traumatique chez leurs patients, psychiatres et psychologues utilisent généralement des questionnaires spécifiques. L’un des plus récents, intitulé « Échelle de sévérité des symptômes de l’état de stress post-traumatique chez l’adulte », a été élaboré par le psychiatre américain Dean G. Kilpatrick et ses collègues en 2014, et est en adéquation avec les critères diagnostiques du DSM-5.
Une fois le stress post-traumatique identifié, le patient peut envisager différentes approches thérapeutiques pour sa reconstruction, telles que l’hypnose, l’EMDR (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires), la thérapie de groupe, la psychanalyse, ainsi que les thérapies cognitives et comportementales (TCC).
Les thérapies comportementales et cognitives pour vaincre le stress post-traumatique
Les thérapies comportementales et cognitives (TCC), employées également dans le programme TheraSerena, sont les plus recommandées pour la prise en charge d’un stress post-traumatique. Elles s’intéressent essentiellement aux symptômes et aux ressentis du patient, elles agissent sur toutes les composantes du stress pour retrouver la sérénité. Elles abordent la question sous plusieurs angles et tiennent compte du comportement, des émotions et de l’aspect cognitif (mémoire, raisonnement, décision, perception…).
Elles s’articulent autour de :